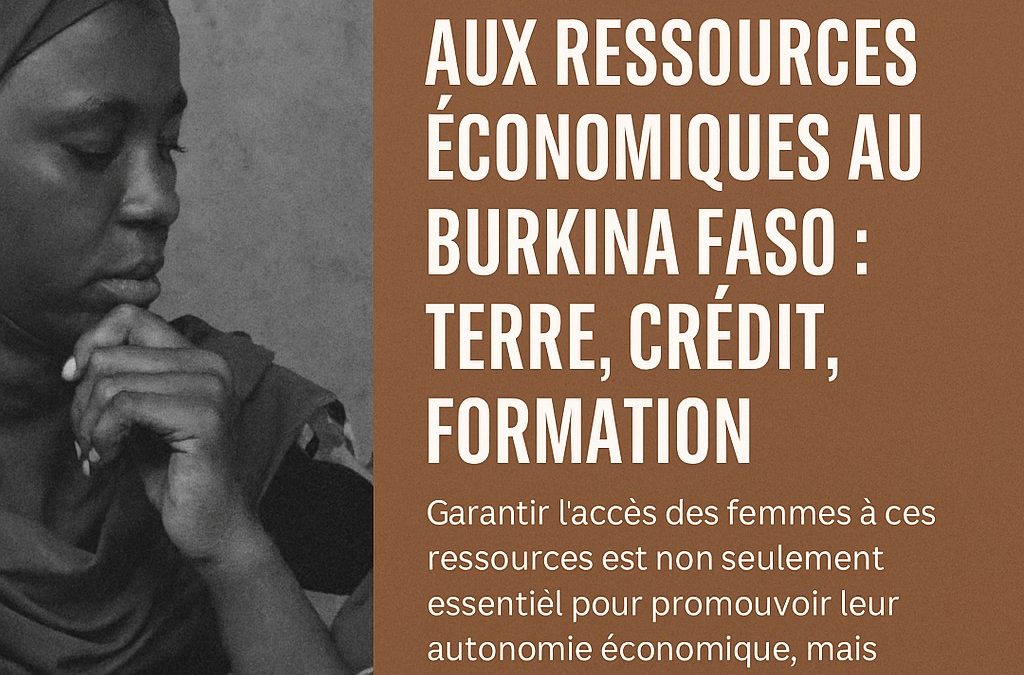🌍 Résilience climatique & justice environnementale: deux piliers pour une transition juste et durable
octobre 13, 2025
🎗️Novembre Bleu : Prenons soin de la santé des hommes
novembre 10, 2025Femmes et accès aux ressources de production au Burkina Faso : sauter les verrous, activer les leviers
Au Burkina Faso, les femmes sont les piliers invisibles de l’économie rurale. Elles produisent, transforment, commercialisent. Pourtant, leur accès aux ressources économiques reste entravé par des normes sociales, juridiques et institutionnelles qui freinent leur autonomie.
🔹 La terre : un droit encore fragile
En dépit des nombreuses législations foncières adoptées, l’accès des femmes à la propriété foncière en milieu rural burkinabè reste encore faible (22,52%), contraint par les normes et règles sociales qui ne leur sont pas toujours favorables (IDRC, 2017 ; UAPS, 2024).
Dans de nombreuses régions, elles cultivent sans titre, sans garantie, sans voix dans les instances de gestion foncière. Lorsqu’elles acquièrent un droit d’usage, leur contrôle effectif sur la terre (possibilité d’en disposer, d’en hypothéquer, d’en tirer des revenus) reste tout de même limité et l’accroissement de la valeur foncière amplifie cette injustice. Comme le prévoit la théorie économique des droits de propriété (Coase, 1960)[1], cela limite leur capacité à investir, à planifier, à transmettre (Banque Mondiale, 2023 ; Koe Raoul Minfede, 2024).
🔹 Le crédit : un outil sous-utilisé
Les microfinance et programmes ciblés ont certainement amélioré l’offre, et une part importante des clientes sont des femmes. Malgré cela, comparativement aux hommes, les femmes sont relativement exclues des circuits formels de financement. Faible bancarisation, faible capacité de garanties, etc… autant d’obstacles qui les enferment les femmes dans des formats de crédits ou microcrédits peu adaptés. Pourtant, les expériences de finance inclusive montrent qu’elles sont des emprunteuses fiables et innovantes.
🔹 La formation : un levier sous-exploité
Des offres de formation (professionnelles, techniques, entreprenariat) existent et, parfois ciblées sur les jeunes filles et femmes. Mais le contenu, le calendrier, et l’accompagnement post-formation limitent l’employabilité et l’accès aux marchés : liens faibles avec la demande locale, manque d’appui à la commercialisation et aux chaînes de valeur, etc. Dans un tel contexte, il est urgent de concevoir des parcours flexibles, contextualisés, et porteurs de transformation durable, particulièrement pour les actrices du secteur informel.
👉 Ce que propose GRAAD Burkina. En tant que Think Tank (laboratoire d’idées) engagé pour l’équité et le développement durable, GRAAD Burkina plaide pour :
- Un renforcement de la dynamique engagé par les autorités burkinabè et leurs partenaires pour une reconnaissance juridique accrue des droits d’usage des femmes en matière de foncier, via des mécanismes hybrides couplés à des campagnes d’information communautaire et de sensibilisation des autorités coutumières et religieuses, en particulier les chefs de terre.
- Des mécanismes de financement plus adaptés, incluant garanties solidaires, digitalisation et accompagnement.
- Des programmes de formation inclusifs, coconstruits avec les bénéficiaires et ancrés dans les réalités des territoires.
- Approche intégrée genre + sécurité : interventions adaptées aux zones affectées par la crise (formations décentralisées, protection, appui à l’accès aux marchés locaux, etc.).
📌 Au regard de leur contribution à l’économie nationale, l’accès des femmes aux ressources économiques n’est pas une question sectorielle : c’est un enjeu de transformation systémique. C’est aussi une opportunité stratégique pour bâtir une économie plus résiliente, inclusive et durable.
GRAAD Burkina s’engage à documenter, expérimenter et éclairer les politiques publiques en ce sens. Parce que l’équité ne se décrète pas : elle se construit, ensemble.
Dr Gountiéni Damien LANKOANDE
Secrétaire Exécutif du GRAAD
Références bibliographiques
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44. https://links.jstor.org/sici?sici=0022-2186%28196010%293%3C1%3ATPOSC%3E2.0.CO%3B2-F
- IDRC. (2017). Pourquoi les droits fonciers des femmes sont essentiels. https://idrc-crdi.ca/fr/perspectives/pourquoi-les-droits-fonciers-des-femmes-sont-essentiels
- UAPS. (2024). Femme et propriété foncière en milieu rural burkinabè. https://uaps2024.popconf.org/abstracts/191530
- Minfede, K. R. (2024). La participation des femmes au marché du crédit réduit-elle leur discrimination à l’égard de la propriété foncière ? Économie rurale, 389. https://journals.openedition.org/economierurale/13157 ; https://doi.org/10.4000/127m0
- IFAD. (2020). Aider les femmes rurales à s’assurer des droits fonciers. https://www.ifad.org/fr/w/paroles-rurales/aider-les-femmes-rurales-a-s-assurer-des-droits-fonciers
[1] (Ronald Coase (1960), Armen Alchian (1959, 1961, 1965), Harold Demsetz (1966, 1967), Henry Manne (1965), Steven Cheung (1969), Erik Furubotn et Svetozar Pejovich (1972 et 1974), et Louis De Alessi (1983)